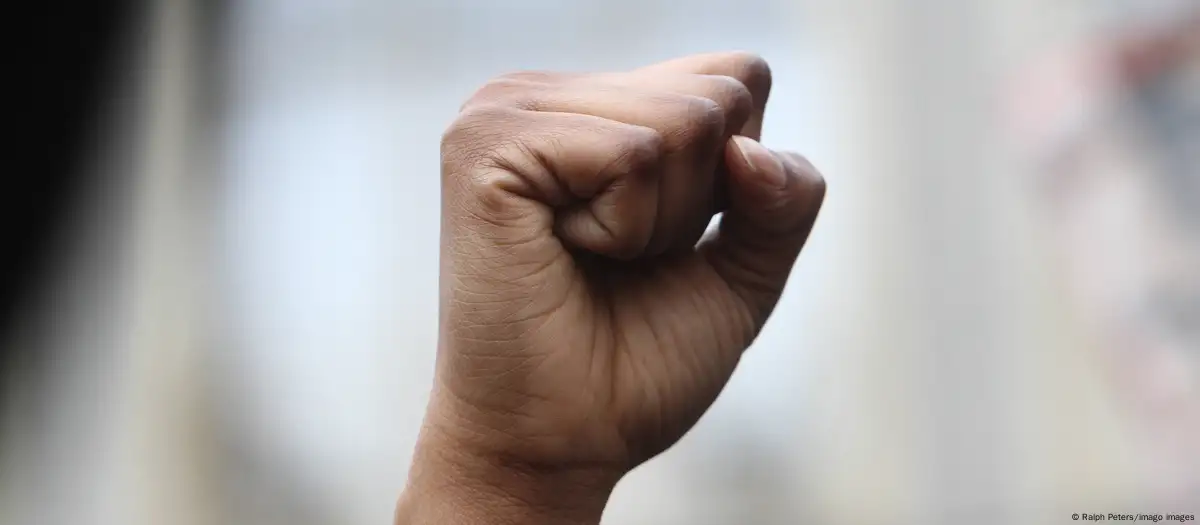
Le 10 décembre, le monde célèbre les droits humains. Reconnus internationalement, ces droits sont aussi très critiqués. Interview avec Xavier Dupré de Boulois,professeur de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le 10 décembre, c’est l’anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme par les Etats membres des Nations unies, en 1948.
Cette date a donc été choisie pour commémorer les droits humains chaque année. Et elle est l’occasion de réfléchir à ces principes posés comme universels, au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Xavier Dupré de Boulois : Il y a une remise en cause, pas des droits de l'homme en eux-mêmes, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'Etats aujourd'hui qui nient les droits de l'homme.
Mais disons qu'ils défendent les droits de l'homme à leur sauce.
Il est toutefois vrai qu’il y a une remise en cause des droits de l'homme dans le champ intellectuel, avec des critiques d'origines assez diverses.
Il y a une critique qui vient des religions hostiles aux droits de l'homme – non pas en général, mais à certains d'entre eux, et notamment tous ceux qui marquent l'émancipation de l'individu dans la famille.
Vous avez un deuxième discours qui, lui, repose plutôt sur la réfutation de l'universalisme des droits de l'homme, qui part du constat qu'effectivement ces droits ont été consacrés en Occident. Que c'est une conception occidentale qui n'a pas empêché le colonialisme.
C'est une conception qui est très largement théorisée en Chine. Et c'est aussi un discours qu'on retrouve en Afrique, effectivement, où [certains critiquent] cette conception occidentale qui était une conception de domination. Ça, c'est la seconde critique.
La troisième, ça reste la critique socialiste qui dénonce surtout la valorisation des droits sociétaux aux dépens des droits sociaux.
Il y a également une quatrième critique dans le champ intellectuel qui provient de certains courants de l'écologie politique qui ont stigmatisé une conception de l'homme dans la société qui aurait justifié la primauté de l'homme sur la nature.
Cependant, il y a beaucoup de nuances dans ces discours-là et, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a plus aucun État qui nie l'existence des droits de l'homme. Y compris des états du type de l'Arabie Saoudite, ou de la Chine.
C’est-à-dire que des États qui sont quand même des États fondamentalement autoritaires se prévalent d'une conception des droits de l'homme, mais qui s'inscrit en rupture avec celle qui est censée venir d'Occident.
DW : Pourtant, dans la pratique, les violations de ces principes sont monnaie courante, y compris dans les démocraties occidentales d'ailleurs.
Oui, bien sûr. C'est vrai que les droits de l'homme restent un combat.
Et effectivement, malgré les grandes proclamations, les pays occidentaux ont aussi encore leur part de zones d'ombre en la matière, surtout vers les marges : concernant la situation des migrants, mais aussi la situation des détenus.
Donc non, on n'est pas arrivé au bout d'un processus ni de ce vers quoi on veut tendre.
Bien sûr, chacun a sa part de difficultés en la matière.
Sandrine Blanchard
Journaliste au programme francophone de la Deutsche Welle
DW
