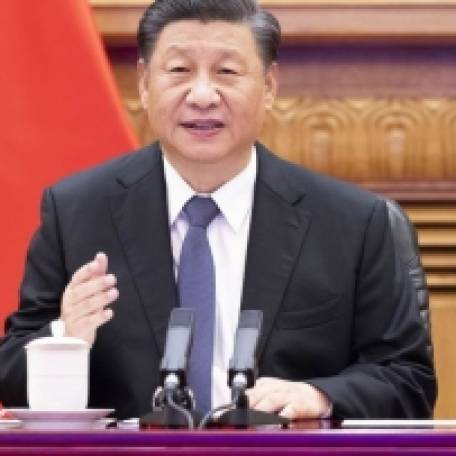Déjà déficitaire en médecins, le Sénégal est confronté à un phénomène de fuite des cerveaux vers la France. Une tendance qui a des répercussions sur le système sanitaire sénégalais. Le docteur Abdoulaye Diop fait défiler les images sur son smartphone : Tulle, Périgueux, la région du Gard…
Déjà déficitaire en médecins, le Sénégal est confronté à un phénomène de fuite des cerveaux vers la France. Une tendance qui a des répercussions sur le système sanitaire sénégalais. Le docteur Abdoulaye Diop fait défiler les images sur son smartphone : Tulle, Périgueux, la région du Gard…
Les offres de remplacement et propositions de gardes pour des maternités en France s’accumulent. « J’en reçois une dizaine par semaine », s’amuse le gynécologue-obstétricien sénégalais qui exerce dans une clinique privée de Dakar.
Si ce « pur produit du système sénégalais » n’envisage pas de s’installer en France et se contente d’un déplacement annuel à Paris pour se former dans sa discipline, force est de constater qu’une partie des médecins sénégalais sont séduits par ces opportunités qui combinent salaire attractif et prise en charge du logement et transport. « Plusieurs confrères font régulièrement les allers-retours Sénégal-France pour des remplacements dans les hôpitaux français ou vont même s’y installer. En un mois, ils peuvent gagner ce qu’ils toucheraient en six mois ici ! », détaille-t-il.
Ces médecins étrangers qui font tourner l’hôpital
Difficile de chiffrer l’ampleur de cette « fuite des cerveaux » du Sénégal vers la France faute de données suffisantes. La tendance s’est accentuée ces dernières années avec le besoin croissant en ressources humaines dans le secteur du côté français. Un attrait qui joue sur la faible rémunération des médecins, sur un plateau médical défaillant et des conditions de travail difficiles dans le système public sanitaire sénégalais. Les structures françaises proposent, elles, « des conditions d’exercice plus attrayantes », un plateau médical de pointe et « une motivation financière plus importante ».
« L’exode des médecins africains est une réalité : beaucoup de professionnels sénégalais exercent en France, et nombreux sont des spécialistes. Il y a une vraie saignée », déplore le docteur Boly Diop, président de l’Ordre des médecins du Sénégal. Si la France préfère miser sur du personnel déjà diplômé, les étudiants sont aussi concernés, car nombre d’entre eux y viennent pour se spécialiser, effectuer un stage en hôpital, et tous ne rentrent pas.
Alors que chaque année, les universités et les écoles privées sénégalaises forment environ mille médecins, l’Etat n’en recrute que « cent pour les structures publiques sanitaires et ne peut pas absorber tout le flux de diplômés », explique le professeur Bara Ndiaye, doyen de la faculté de médecine, pharmacie et d’odonto-stomatologie de Dakar. En 2017, le pays comptait 7 médecins pour 100 000 habitants selon la Banque mondiale, loin des recommandations de l’OMS qui estime qu’à moins de 2,3 agents de santé (médecins, infirmières, sages femmes) pour 1 000 habitants les besoins en santé primaires ne sont pas suffisamment couverts.
« Les structures publiques sont en sous-effectifs et les professionnels de santé sont submergés par le nombre de patients », raconte le docteur Edmin Diatta, psychiatre au centre hospitalier de Fann, à Dakar. Le déficit de médecins, surtout de spécialistes, est flagrant en milieu rural. « Travailler dans le service public de la santé au Sénégal est un sacerdoce. Mais c’est notre population, on ne peut pas l’abandonner », argumente le docteur Mamadou Demba Ndour, gynécologue-obstétricien dans la région de Matam (nord-est) et secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES).
Les médecins, des migrants dont les pays riches veulent bien
Faute de places suffisantes dans le public, les jeunes diplômés se tournent vers le privé, mais aussi vers l’étranger. D’autant qu’ils sont très sollicités hors des frontières puisqu’ils sont déjà qualifiés et expérimentés. « Il n’y a pas vraiment de problème de reconnaissance des compétences. Ils doivent fournir une attestation de l’Ordre des médecins et passer une “épreuve de vérification des connaissances (EVC) », informe le docteur Boly Diop. Ils peuvent également venir suivre leur spécialité ou la terminer en France. Grâce à une convention entre l’Ordre des médecins du Sénégal et le consulat de France, l’octroi de visas de longue durée, s’il n’est pas garanti, s’avère aisé.
« Leur juste valeur »
« Si les hôpitaux français fonctionnent actuellement, c’est beaucoup grâce à la main-d’œuvre étrangère », tranche le docteur Birane Beye, gastro-entérologue, formé en endoscopie interventionnelle en France, exerçant désormais entre Dakar et Orléans. Mais ce départ de médecins compétents préoccupe les professionnels du secteur au Sénégal. Ils craignent que la carte de séjour spécifique « talent-professions médicales et pharmacie » du projet de loi sur l’immigration et l’intégration en France, présenté en conseil des ministres mercredi 1er février, destinée à « améliorer l’attractivité » de l’Hexagone, n’intensifie les départs de médecins sénégalais.
« Ce projet aggravera l’hémorragie déjà existante et accentuera les déserts médicaux. Cela va rebondir sur la prise en charge locale des patients et retarder notre développement », craint le docteur Abdoulaye Diop.
D’autres praticiens tentent d’y voir des retombées plus positives pour le pays. « Cela peut être une opportunité pour renforcer les compétences des médecins sénégalais qui pourront ensuite les importer au Sénégal », espère le docteur Ndour. En effet, nombreux sont ceux à être partis pour acquérir de nouvelles techniques, bénéficier d’un plateau technique de pointe, mais désireux de rentrer au Sénégal pour y développer la médecine.
L’Afrique redoute un exode plus massif vers la France de ses médecins, un des « métiers en tension » du projet de loi immigration
Pour freiner cette hémorragie de talents, les praticiens appellent l’Etat à se positionner. Malgré des efforts depuis ces dix dernières années pour revaloriser les salaires, améliorer le plateau technique et construire de nouvelles infrastructures, les besoins restent conséquents. « Les médecins “patriotes” restent pour faire avancer le pays, mais même eux ont besoin d’avoir de meilleures options : des aides pour l’installation, une hausse de la rémunération, des meilleures conditions de travail », insiste le docteur Abdoulaye Diop.
D’ores et déjà, la question de la rémunération moindre des médecins étrangers par rapport à leurs homologues français, une « discrimination ne se justifiant pas » selon le professeur Ndiaye, ainsi que le « parcours de consolidation des compétences » imposé pendant deux ans aux médecins étrangers après l’EVC avant de pouvoir envisager d’être inscrits à l’Ordre des médecins français et d’exercer librement en France, sont vivement critiqués. Ils ont officiellement le statut de « faisant fonction d’interne » (FFI) sans en avoir le salaire. « Ces médecins ont toutes les compétences et l’expérience nécessaires et sont pourtant sous tutelle d’un médecin français. Ils ne sont pas traités à leur juste valeur », s’agace le docteur Beye.
Alice Hautbois
Le Monde